Voici un texte que j'ai écris pour le numéro de septembre 2025 de mon journal syndical. J'écris rarement en Français sur mon blog (qui est principalement destiné à un auditoire international), mais cela m'arrive quand même parfois!
Introduction
Dès l'introduction, Plourde annonce ses couleurs: ce livre s'adresse aux personnes qui croient en un système de santé universel, mais qui doutent de la capacité du système public d'y arriver.
Dans ce livre, cette dernière s'attaque plus particulièrement à « la 'Santé Inc.', et donc aux entreprises (qu'il s'agisse de grandes multinationales ou d'entrepreneurs indépendants) qui mènent leurs activités dans l'objectif d'en tirer un profit - ce qu'on appelle communément le secteur privé à but lucratif. » (p.14-15)
Le livre est divisé en 5 chapitres, qui abordent chacun un mythe.
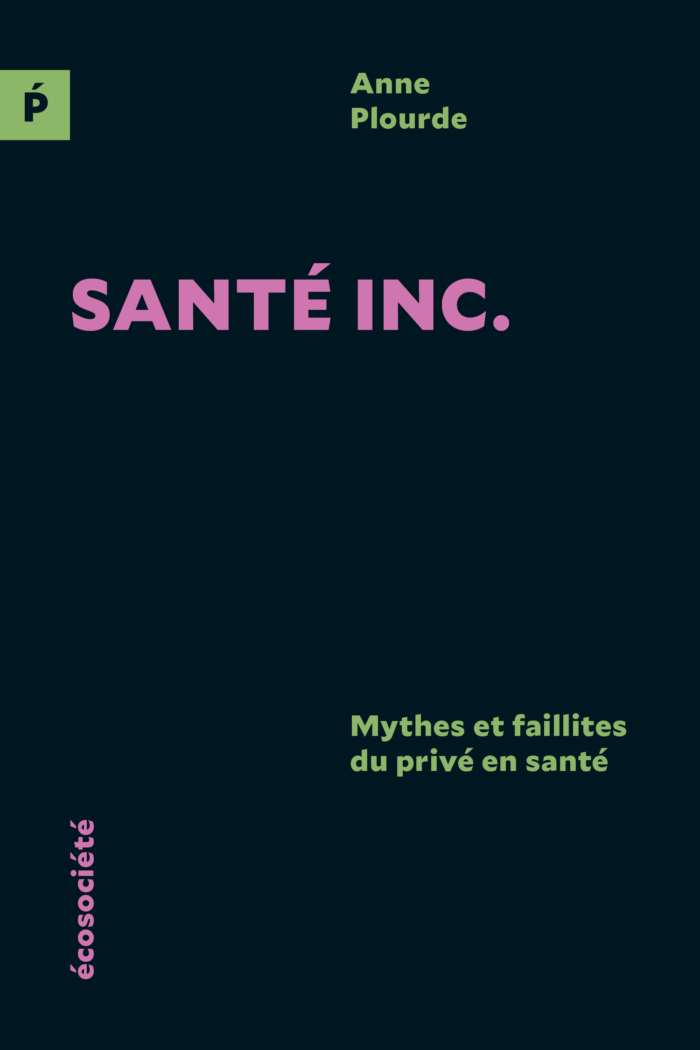
Faillite 1: Le privé en santé échoue depuis un siècle
Mythe: le système de santé est essentiellement public, le privé est une nouveauté.
Ce chapitre aborde l'histoire du système de santé au Québec. Plourde affirme ainsi qu'à partir du XX^e^ siècle, les avancées de la médecine font en sorte que les hôpitaux deviennent de réels lieux de soins (plutôt que des lieux de prise en charge des 'indigents')
En effet, mis à part la tranche de population très pauvre pour qui les soins sont gratuits, la forte majorité des gens n'ont pas accès aux soins pour des raisons financières.
À partir des années 1930, les syndicats réussissent à gagner la mise en place d'assurances privées sur les milieux de travail. Ce gain initial s'avère en fait être un échec, car les progrès de la médecine s'accompagnent d'une explosion des coûts, que les assurances collectives ont bien de la misère à assumer.
À partir des années 1950, ce système ne fonctionne plus (il n'a jamais réellement fonctionné...) et même les hôpitaux se montrent ouverts à la création d'une assurance publique universelle.
Plourde brosse un portrait des services offerts à cette époque et démontre qu'en fait, que ce soit à cause des coûts ou à cause de la présence de déserts médicaux dans les quartiers et régions rurales jugées non rentables par le privé, seuls les riches ont accès aux services de santé.
C'est dans ce contexte qu'en 1971 la commission Castonguay-Nepveu propose la mise en place d'une assurance publique et universelle:
« [...] la commission Castonguay-Nepveu recommandait non seulement l'adoption d'une assurance maladie publique et universelle, mais également la nationalisation de l'ensemble des services de santé et des services sociaux et leur intégration dans un système entièrement public. » p.29
L'État crée donc les CLSC, dans une optique de soins publics, démocratiques et holistiques. En plus d'offrir des soins de santé, ces derniers reçoivent comme mandat l'inclusion démocratique des patient·e·s dans le réseau de santé ainsi que la lutte contre les enjeux de santé causés par des facteurs comme la malnutrition, la pollution, l'insalubrité des logements, etc.
Les nouveaux CLSC sont cependant mis à mal par le refus des médecins d'abandonner leur statut de travailleurs autonomes et de devenir salarié·e·s. Suite à d'intenses campagnes de lobbying, l'État accepte finalement qu'ils restent la seule catégorie de travailleuses et de travailleurs de la santé à avoir des cabinets privés tout en pouvant bénéficier d'un financement public. Cette condition vient cependant avec l'impossibilité de travailler au privé.
Les autres catégories de professionnel·le·s de la santé (psychologues, dentistes, etc.) peuvent cependant continuer de recevoir du financement privé, ce qui permet la survie des assurances privées. En effet, à l'instar de la commission Parent, la commission Castonguay-Nepveu croit qu'il est plus stratégique d'augmenter graduellement la couverture des soins de santé à travers les années pour tenter de minimiser le choc fiscal initial. Cela n'arrivera toutefois jamais.
Ploudre démontre ainsi que le pourcentage des dépenses privées des ménages dans le total des dépenses de santé au Québec a en fait augmenté depuis les années 70. En 2021, un ménage moyen dépensait 2897$ en soins privés, pour un total de 19,4 milliards de dollars (25,8% du budget total public-privé en santé). Ce pourcentage en 1970 était d'environ 20%.
Preuve de la faillite des CLSC, de nos jours, seul 15% des médecins de famille y pratiquent. La forte majorité travaillent ainsi dans des cliniques privées, les GMF.
La conclusion de ce chapitre est donc que le privé ne peut pas sauver le réseau de la santé, car il n'a jamais réellement été chassé du réseau!
Faillite 2: Le privé en santé échoue à réduire les coûts
Mythe 2: le privé coûte moins cher
« Cela est vrai tant pour le financement privé que pour la prestation privée des services » p.46
L'auteure affirme qu'un problème majeur du régime québécois est le régime privé d'assurance médicaments, qui entraîne la multiplication des frais de gestion et brise le pouvoir de négociation collectif dont jouirait un régime public et universel. Pire encore, il laisse au public les cas les plus coûteux (soit les pauvres, qui sont statistiquement plus malades que les riches).
De plus, Plourde note que le marché privé vise le profit et non la promulgation de soins. Quand le rapport de force des entreprises est important, les prix montent:
« Ainsi, en pleine crise de santé mentale, les tarifs suggérés par l'Ordre des psychologues du Québec en 2023 étaient 50% plus élevés que ce qui était affiché sur le site en 2021. » p.49
Plourde affirme également que lorsque le privé arrive à réaliser certains actes à coûts plus faibles que le public, c'est parce qu'il rogne sur les conditions de travail et sur la qualité des services, deux choses qui ne sont pas désirables.
À son avis, un facteur majeur dans l'augmentation des coûts en santé est le fait que les médecins accaparent une partie très importante du budget de la santé au Québec:
« Alors que les médecins ne représentaient que l'équivalent de 6% des effectifs du réseau, cette profession accaparait à elle seule 15% des dépenses totales du MSSS en 2021-2022. La même année, les autres employé·e·s du réseau public, qui constituent donc 94% des effectifs, ont reçu une rémunération totale équivalent à moins de 30% des dépenses du MSSS.
La rémunération individuelle moyenne des médecins est de près de 400 000$ par année, ce qui est 6,4 fois plus élevé que la rémunération moyenne des autres employé·e·s du réseau, et 8,2 fois plus que le revenu d'emploi moyen de l'ensemble des travailleuses et travailleurs du Québec. » p.61
Plourde termine le chapitre en démontrant que les expériences faites sur les coûts en clinique privée au Québec et ailleurs au Canada démontrent systématiquement que le privé coûte substantiellement plus cher.
Faillite 3: Le privé en santé échoue à être efficace
Mythe 3: le privé est plus efficace
« la Commission Castonguay-Nepveu ne s'est pas contentée de recommander la nationalisation des services de santé: elle a également recommandé leur démocratisation. » p.73
Lors de la création des CLSC, les conseils d'administration sont formés de patient·e·s et de membres de la communauté. L'idée de démocratisation de la santé est alors explicite:
« Cette petite révolution représentait non seulement une importante perte de pouvoir pour les élites économiques, mais elle offrait aussi à la population des outils pour résister aux assauts que ces mêmes élites n'allaient pas tarder à lancer contre le nouveau système public. » p.74
Malheureusement, cette vision de la santé est mise à mal par l'imposition de pratiques de gestion néolibérales:
« Loin d'améliorer l'efficacité des services, ce processus de déconnexion grandissante avec le terrain aboutit donc, en contradiction complète avec les recommandations de la Commission Castonguay-Nepveu, à la destruction progressive des capacités du réseau à connaître les besoins réels de la population et d'y répondre adéquatement. » p.77
Conséquence de cette déconnexion, cette bureaucratisation accrue fait augmenter les coûts. Plourde affirme par exemple que les gens qui prodiguent des soins à domicile passent près de 70% de leur temps de travail à effectuer des tâches administratives.
« Cette centralisation des pouvoir promue par les nouvelle gestion publique et le milieu des affaires s'accompagne nécessairement d'une bureaucratisation des services, puisque, au fur et à mesure que les gestionnaires détenteurs d'un pouvoir réel s'éloignent du terrain, des mesures de contrôle administratifs de plus en plus lourdes et complexes doivent être développées. Celles-ci prennent par exemple la forme d'exigences de reddition de comptes statistiques auprès du personnel qui dispense les soins et les services. » p.76
Un autre exemple de bureaucratisation du système de santé est le financement à l'acte:
« Durant les années 1980, environ 600 actes pouvaient faire l'objet d'une facturation de la part des médecins auprès de la Régie de l'assurance malade. En une trentaine d'années, ce nombre déjà faramineux est passé à ... 11 000! La gestion de la rémunération médicale est si lourde et si complexe que les médecins eux-mêmes peinent désormais à s'y retrouver dans leur propre facturation et doivent faire appel à des firmes spécialisées pour accomplir ces tâches. » p.80
Pire encore:
« [...] le financement à l'activité a l'avantage considérable de mettre un prix précis sur chaque activité hospitalière et, du même coup, de faciliter leur achat et leur vente (et donc leur privatisation). » p.83
Plourde s'attarde par la suite à prouver l'inefficacité de GMF. Alors que ces cliniques privées ont été créés pour désengorger les urgences en offrant de plus longues plages horaires, cela ne semble pas avoir eu l'effet désiré. En effet, depuis leur création, les GMF n'ont jamais atteint les cibles de prise en charge de patient·e·s imposées par les gouvernements.
Comme les GMF sont incapables (lire: ils refusent) de prendre en charge des patient·e·s dans des plages horaires considérées comme peu attrayantes par les médecins (tard le soir et les fins de semaine), il leur est permis de signer des contrats avec d'autres organismes pour que ces derniers offrent cette prise en charge à leur place. Ainsi:
« En 2022, 41% des GMF avaient convenu de telles ententes et offraient donc une quantité d'heures de services inférieures à celle prévue par le programme GMF. Mais le plus surprenant et le plus choquant, c'est qu'au moins 37% de ces ententes ont été conclues avec les services d'urgence d'un hôpital! » p.87-88
Malgré ces manquants, les GMF continuent néanmoins de recevoir l'ensemble de leur financement.
Autre absurdité de ce système: le Ministère a décidé de 'prêter' gratuitement aux GMF des employé·e·s travaillant dans les CLSC pour combler leurs besoins en services de travail social et en psychologie:
« À partir de 2016, à la suite d'une directive du ministère en ce sens, une quantité grandissante de travailleurs sociaux et de travailleuses sociales ainsi que des psychologues qui pratiquaient jusqu'alors dans les CLSC ont été mis·e·s à la disposition des GMF, gratuitement, par les établissements publics. Officiellement, ces professionnel·le·s restent à l'emploi des établissements publics, mais ils et elles sont placé·e·s sous 'l'autorité fonctionnelle' des médecins de GMF et pratiquent dans leurs locaux. » p. 88
Une conséquence encore plus regrettable de ce système est la perte d'accès à ces services dans les CLSC:
« Ainsi, seules les personnes inscrites auprès d'un médecin de GMF ont accès aux professionnel·le·s qui y sont transféré·e·s par les établissements publics. Or, plus du tiers de la population du Québec n'a toujours pas cette chance. » p.89
Plourde répertorie ainsi une perte de 42% de l'offre de service en travail social (700 000 heures/an) et de 52% en psychologie (60 000 heures/an) dans les CLSC dans les dernières années.
Constatant les problèmes importants des GMF, le gouvernement a par la suite décidé de favoriser la création de super-GMF, qui offrent des services comme des radiographies, des prélèvements et doivent servir en théorie de 'mini-urgences'. Plourde démontre cependant qu'en 2017, 62% de ces groupes n'atteignaient pas le nombre minimal de visites exigées. En 2021, cette proportion était de 82%.
Elle constate finalement que pour tenter de remplir leurs quotas, les médecins de ces super-GMF ont tendance à délaisser leurs propres patient·e·s, qui doivent alors se tourner vers l'urgence ou d'autres super-GMF...
On en comprend donc que le privé n'est pas réellement plus efficace que le public en santé.
Faillite 4: Le privé en santé échoue à désengorger le public
Mythe 4: le privé aide à réduire les listes d'attente dans le public
« [...] dans les faits, le privé est plutôt un compétiteur féroce qui vampirise les ressources du public et réduit sa capacité à répondre aux besoins de la population » p. 95
C'est surtout le cas car la main d'œuvre en santé est finie et que le privé tend donc à 'voler' des travailleuses et des travailleurs qui iraient autrement au public. En général, si le privé arrive à être plus attractif, c'est parce qu'il est en mesure d'offrir de meilleurs salaires que le public et parce qu'il n'a pas besoin d'offrir des services 24h/24 7j/7.
En 1987, près de 60% des personnes dans le domaine de la santé et de l'assistance sociale travaillait au public. En 2019, ce n'était plus le cas que de 50% des travailleurs et travailleuses de ce domaine.
Selon Plourde, cette situation est causée par trois problèmes:
- Le désengagement de l'État et les coupures budgétaires
- La détérioration des conditions de travail
- Le fait que l'État paie plus cher pour un même service offert au privé qu'au public
Cette dernière parle ainsi de 'ponts d'or' du public vers le privé pour décrire cette situation.
« Les difficultés à réduire les listes d'attente pour le type de procédures qui sont privatisées dans ces cliniques ne sont pas causées par des manques d'équipement ou de salles d'opération dans les hôpitaux publics. Elles sont causées par le manque de disponibilité du personnel, problème majeur qui force les hôpitaux à sous-utiliser leurs salles d'opération. » p.104
Face à ces problèmes, l'auteure remet de l'avant le fait que les barrières mises en place pour empêcher que les médecins ne travaillent au privé fonctionnent. En effet, très peu de médecins travaillent au public (~4%) alors qu'au contraire la pratique privé-publique est très populaire chez les physiothérapeutes ou les psychologues. Ces barrières pour empêcher la double pratique devraient donc être graduellement mises en place pour les autres professions, dans une optique de renationalisation des soins.
En effet, alors que de 2010 à 2020 le nombre de psychologues au Québec a augmenté de 5,5%, la crise de l'accessibilité s'est aggravée. Alors qu'en 2010, 28% des psychologues travaillaient dans la santé publique, en 2020, elles et ils n'étaient plus 23% à le faire. Pendant ce temps, la pratique privée a récupéré ces gens.
Plourde termine ce chapitre en mettant en garde contre la télémédecine, qui, n'étant pas offerte au public, est un service qui peut être offert par les médecins sans remettre en cause leur appartenance au réseau public. Elle craint en effet que cette pratique mixte ne prenne de l'ampleur, au profit du privé.
Faillite 5: Le privé en santé échoue à préserver la qualité et l'équité
Mythe 5: le privé améliore la qualité des soins sans nuire à l'équité dans l'accès aux services
« On nous fait croire également que lorsque des personnes mieux nanties paient pour avoir accès plus rapidement aux services dans le secteur privé, elles libèrent de la place dans le secteur public, facilitant ainsi l'accès pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer pour des services privés. » p. 124
Dans ce dernier chapitre, Plourde affirme que la décision de privatiser encore plus notre système de santé est une entreprise d'abord et avant tout idéologique. En effet:
« [...] une revue de la littérature internationale a montré en 2014 que la mortalité et les coûts des services étaient plus élevés dans les établissements de santé privé à but lucratif que dans les organismes sans but lucratif. » p. 126
Ces effets sont connus depuis longtemps déjà, le Québec n'étant pas le premier à s'engager dans ce chemin. Dès 1990, l'Italie privatise plusieurs services de santé et devient un contre-exemple marqué. On constate ainsi que plus le pourcentage de services assurés par le privé est grand, plus la mortalité des patient·e·s est importante. Des constats similaires ont été faits suite aux privatisations en santé en Angleterre en 2013 et en 2020 en Colombie-Britannique.
Selon Plourde, cette surmortalité est le résultat de la création d'un système à deux vitesses. En effet, alors que statistiquement les personnes plus aisées sont plus en santé, grâce au système privé, elles ont accès à des soins plus rapidement. À l'inverse, les personnes les plus pauvres sont obligées de se retourner vers le système public, définancé au profit du privé.
On en revient donc à la conclusion générale que:
« Traiter la maladie comme une source de profits ne conduit pas à l'amélioration de la santé et des services, bien au contraire. Persévérer dans la voie néfaste d'une privatisation accrue des services serait donc une grave erreur. » p. 154